PIXAR MET L'HOMME AU RANCART
Essai
Par Maxime Rovere
 Faire découvrir cet article à un ami
Faire découvrir cet article à un ami
La sortie dans les salles de 'Cars 2' rend indispensable la lecture de l'essai de Hervé Aubron, 'Génie de Pixar'. Selon lui, l'humanité devient quantité négligeable et les créatures du studio inventeraient leurs propres codes. Plongée dans un monde où la machine est souveraine.
 |
Humanoïdes dissociés
Dans 'Génie de Pixar' (Ed. Capricci), Hervé Aubron inverse la vapeur : contre l'idée que ces films d'animation sont d'abord des créations humaines (ce qui semblerait évident), il propose de prendre au sérieux la part de l'informatique dans la fabrication des images, et donc dans l'élaboration du sens. Il ne s'agit pas de craindre l'influence des machines. La révolte des robots contre leurs créateurs était un fantasme du XXe siècle, et il a fait son temps. Pourquoi ? Parce que, dit cet ancien membre du comité éditorial des Cahiers du cinéma, « cela ne se passera pas un jour, cela se passe chaque jour, pas à pas. Et cela n'advient pas sur le mode du complot germant dans les disques durs. Le réseau cybernétique n'est pas un prédateur sournois. Il nous phagocyte, il nous contient (…). Il est un fœtus dont la croissance rend chaque jour plus lente et caduque l'humanité, appelée à se satelliser autour de sa lune « intelligente ». Cela ne va pas arriver, c'est déjà arrivé : la dérégulation financière a permis d'évaluer combien l'accélération des calculs rend mécaniquement plus lourde, sinon indésirable, l'espèce humaine. »
Déplacement des affects
 |
 Zoom Zoom |
Que devient « l'humanité » dans le monde des pixels ? Elle se disloque en deux directions. La première est celle d'une totale migration vers autre chose qu'un corps humain. Cette perspective permet de comprendre que le cinéma d'animation par ordinateur n'est pas un hasard technique. Les films de Walt Disney étaient allés au bout des possibilités de l'anthropomorphisme animal, de sorte qu'il fallait en venir aux machines, pas seulement comme objets, mais aussi comme sujets du discours cinématographique. « La maîtrise de l'imagerie numérique était une nécessité. Il fallait en passer par les ordinateurs (…). Il fallait que les dessins quittent la main humaine, transitent par les ordinateurs, soient déliés en acte de l'homme, au-delà des métaphores ou mises en abyme… » (p.15)
Renouveau du récit merveilleux
Dans ce miroir pixélisé, l'humanité se reconnaît alors dans l'inadéquat, le bricolage, l'accommodement. L'auteur qui enseigne le cinéma de genre (l'horreur) ne semble pas enthousiasmé par l'hypothèse, où il voit en somme « une immense solitude partagée » (p. 87). Mais c'est sans doute qu'il reste ici du côté des machines : « Pour la machine, le choix des jouets (dans 'Toy Story') est la marque d'une limite technologique et, déjà, un diagnostic : à ne pas s'être renouvelé, l'anthropomorphisme est devenu une brocante. Du côté des humains, la perspective est différente : ils réalisent l'ampleur des dégâts, mais fêtent la restauration d'une puissance qui semblait depuis longtemps éteinte, celle du récit merveilleux. » (p. 40)
Antidote ou poison ?
 |
 Zoom Zoom |
 Faire découvrir cet article à un ami
Faire découvrir cet article à un ami
http://www.evene.fr/cinema/actualite/pixar-animation-herve-aubron-homme-cars-toy-story-3091.php





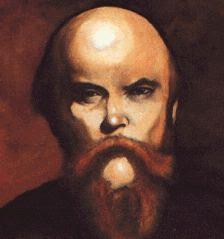






No comments:
Post a Comment